La réforme de la formation professionnelle et l’introduction du Compte Personnel de Formation (CPF) ont profondément modifié les logiques de financement en France. Si l’objectif de rendre le salarié acteur de son parcours est louable, les effets secondaires du modèle CPF ; en particulier sa dépendance aux certifications enregistrées auprès de France Compétences suscitent des interrogations majeures sur la qualité, la diversité et la pérennité des compétences réellement transmises.
Cette réflexion propose d’explorer les impacts systémiques de ce mode de financement, à travers dix effets majeurs, puis d’analyser le risque de perte de savoir-faire qu’il engendre.
1. Restriction de l’offre de formation
L’éligibilité au CPF est conditionnée à l’enregistrement de la formation au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ou au Répertoire Spécifique (RS). Cela exclut de fait un grand nombre de formations courtes, de modules sur-mesure, ou encore de parcours adaptables aux besoins concrets des entreprises.
En imposant un filtre aussi rigide, le CPF écarte des pans entiers de l’offre pédagogique pourtant utiles, ancrés dans les réalités métiers. Ce n’est plus la pertinence du contenu qui prime, mais son statut administratif.
2. Priorité au « certifiable » au détriment du « transférable »
L’exigence de certification conduit à privilégier les compétences normées, déclinées en blocs homogènes, au détriment des compétences transversales, adaptables ou contextuelles. Or, la transférabilité d’une compétence – sa capacité à être réinvestie dans un nouvel environnement, un nouveau poste, une situation complexe est au cœur de l’agilité professionnelle. En favorisant le « certifiable », le système CPF tend à desservir la logique même de développement des compétences durables.
3. Biais de marché : une logique de rentabilité et d’industrialisation
Le marché du CPF, tel qu’il s’est structuré, valorise les logiques d’échelle, d’automatisation et de rendement. Cela pousse les organismes à produire des formations industrialisées : formats standards, contenus génériques, e-learning en masse. Ce modèle laisse peu de place à la pédagogie personnalisée, au diagnostic préalable ou à l’ajustement fin au contexte du stagiaire.

L’industrialisation, en soi, n’est pas un mal ; mais appliquée à la formation humaine et professionnelle, elle finit par fragiliser l’impact réel sur les compétences.
4. Lourdeur administrative et barrières à l’entrée
Obtenir un enregistrement au RNCP ou au RS suppose une ingénierie lourde : constitution de référentiels, preuve d’un usage professionnel, audits, contrôles de conformité. Ces exigences sont souvent hors de portée des indépendants ou des petits organismes, même lorsque la qualité pédagogique est bien présente. La conséquence est une concentration de l’offre entre les mains de structures capables d’absorber cette charge, au détriment de la diversité, de l’agilité, et de l’innovation pédagogique.
5. Détournement de l’objet de la formation
De nombreux organismes, contraints par les règles du CPF, adaptent leurs contenus pour « coller » aux référentiels exigés. On assiste alors à des contournements : certifications peu pertinentes, formations artificiellement reformatées, ajout de modules uniquement pour rendre le tout éligible.
Cela crée un décalage entre les besoins réels du terrain et les logiques de conception pédagogique. La formation devient un produit de consommation plus qu’un vecteur d’apprentissage, et sa raison d’être (la montée en compétences) se trouve diluée.
6. Invisibilisation des experts non certifiés
Le CPF ignore un grand nombre de professionnels expérimentés qui ne disposent pas d’une certification formelle mais qui détiennent un haut niveau d’expertise. Consultants, formateurs, artisans de la pédagogie en entreprise : tous ces profils sont progressivement invisibilisés dans l’offre CPF, car leurs prestations ne sont pas adossées à un titre officiel. Or, c’est souvent dans ces profils que résident des savoirs uniques, issus du terrain, difficilement remplaçables.
7. Perte de savoirs tacites et pratiques
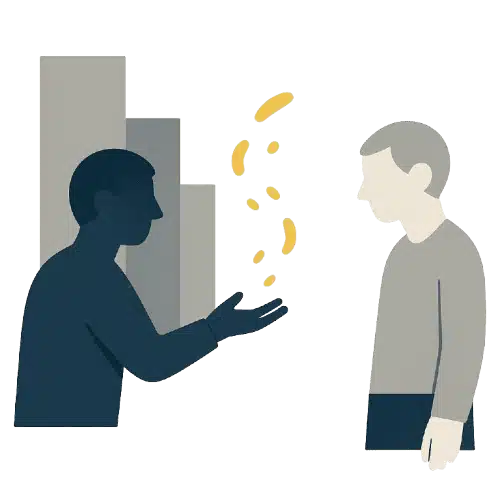
Les savoirs tacites – ces compétences intégrées, souvent informelles, que l’on acquiert avec l’expérience – sont les plus difficiles à formaliser dans un référentiel. En imposant une logique exclusivement centrée sur le certifiable, le système CPF favorise l’oubli progressif de ces savoirs pratiques. Ils ne sont ni enseignés, ni valorisés, ni transmis dans les formations CPF, et risquent à terme de disparaître, malgré leur utilité cruciale dans les contextes opérationnels.
8. Décalage entre référentiels et réalité du terrain
Les certifications évoluent lentement, souvent à contretemps du monde professionnel. Elles peuvent mettre des années à intégrer de nouveaux usages, outils ou pratiques. Pendant ce temps, les entreprises et les métiers évoluent rapidement. Ce décalage crée une tension entre une formation rigide et une réalité mouvante. Or, les formateurs les plus agiles, capables de s’adapter en temps réel, ne sont pas nécessairement ceux qui disposent d’un catalogue certifié.
9. Entrave à la capitalisation collective
La logique CPF ne valorise pas les apports contextualisés, les retours d’expérience ni les innovations pédagogiques locales. Ce qui ne peut être certifié ne peut être financé, donc enseigné à grande échelle.
Cela freine la mutualisation des bonnes pratiques, l’enrichissement croisé entre secteurs, et empêche la constitution d’un patrimoine commun de savoirs utiles. La formation devient un marché cloisonné au lieu d’être un vecteur de transmission partagée.
10. Érosion du métier de formateur indépendant
Enfin, cette logique contribue à une profonde transformation du métier de formateur : moins de liberté pédagogique, plus de contraintes administratives, perte de sens, difficulté à se faire financer sans structure tierce. Nombre de formateurs indépendants renoncent, se recentrent sur le conseil ou quittent le secteur. Cette perte de vocations fragilise l’écosystème, diminue la capacité du système à se renouveler, et accélère l’appauvrissement de la transmission d’expérience.
Risque de perte de savoir-faire : pourquoi c’est un enjeu sérieux
La conséquence la plus préoccupante de ces dérives est la mise en péril de la transmission des savoir-faire, au sens profond du terme. Là où les compétences peuvent être évaluées, objectivées, formatées, les savoir-faire s’enracinent dans l’expérience, le contexte, la relation humaine. Ce sont eux qui donnent de la valeur aux métiers. Leur disparition progressive serait une perte silencieuse mais considérable.
Le savoir-faire ne se limite pas aux compétences certifiables
Les référentiels de certification se focalisent sur des compétences formelles, mesurables, souvent théoriques. Le savoir-faire, quant à lui, relève du geste juste, de l’intuition issue de l’expérience, de la capacité à faire face à des situations complexes et changeantes. Il ne se laisse pas aisément réduire à une grille d’évaluation. En centrant l’offre sur le certifiable, le CPF exclut une part essentielle de ce qui constitue l’intelligence du travail.
Les experts expérimentés partent sans transmettre
De nombreux professionnels très qualifiés, en fin de carrière, porteurs de savoir-faire pointus, n’ont pas les moyens ni l’envie de « faire certifier » leurs formations. Si aucune alternative ne leur permet de transmettre, leurs compétences disparaîtront avec eux. Le système CPF, en les écartant, organise malgré lui une forme de perte sèche, une amnésie programmée des métiers.

Les formations sur-mesure disparaissent du financement public
La formation réellement utile à une entreprise est souvent celle qui s’adapte à ses contraintes, à son vocabulaire, à ses outils. Ce type de formation ne peut entrer dans un cadre standardisé. Or, sans financement, ces prestations sont moins commandées, moins proposées. L’apprentissage en situation réelle, pourtant reconnu comme efficace, se trouve évincé au profit de contenus plus génériques, mais éligibles. C’est un recul en termes d’impact et de valeur ajoutée.
Standardisation vs personnalisation : une tension dangereuse
Le CPF pousse à la standardisation des contenus : titres uniformes, parcours figés, modalités répétitives. Le savoir-faire, au contraire, se transmet dans l’interaction, l’ajustement, la co-construction avec l’apprenant. Ce n’est pas une question de méthode, mais de philosophie. Une formation personnalisée, incarnée, peut transmettre bien plus qu’un module en ligne validé par QCM. Ce modèle est aujourd’hui sous-financé, donc menacé.
Barrière à la documentation des savoir-faire
Enfin, pour qu’un savoir-faire survive, il faut qu’il soit documenté ou transmis en situation. Le CPF ne finance pas les actions de documentation, ni les démarches d’écriture réflexive, ni l’ingénierie de transfert. Les consultants qui détiennent ces savoirs n’ont pas d’incitation à les transmettre autrement que dans des prestations en direct. Faute de reconnaissance, ils ne laissent pas de trace. Le savoir-faire meurt alors dans le silence.
Le CPF, conçu pour démocratiser l’accès à la formation, a indéniablement permis à de nombreux actifs de se former. Mais en verrouillant son financement sur des formations certifiées, il exclut une part précieuse de l’écosystème pédagogique : les experts non certifiés, les formats sur-mesure, les savoirs tacites, les démarches de transmission informelles. Ce choix politique, s’il n’est pas rééquilibré, risque d’appauvrir durablement la formation professionnelle française, en sacrifiant l’agilité, la diversité, et surtout la richesse humaine du savoir-faire.
Ce n’est pas la logique du CPF qu’il faut remettre en cause, mais les effets de bord de son cadre trop étroit. Un système mature devrait pouvoir reconnaître que l’excellence ne se résume pas à un label, et que la compétence ne se certifie pas toujours. La formation professionnelle est un levier stratégique pour les entreprises comme pour la société. Elle mérite un modèle qui valorise à la fois le mesurable et l’intangible, le normé et le vivant, le savoir et le faire.

